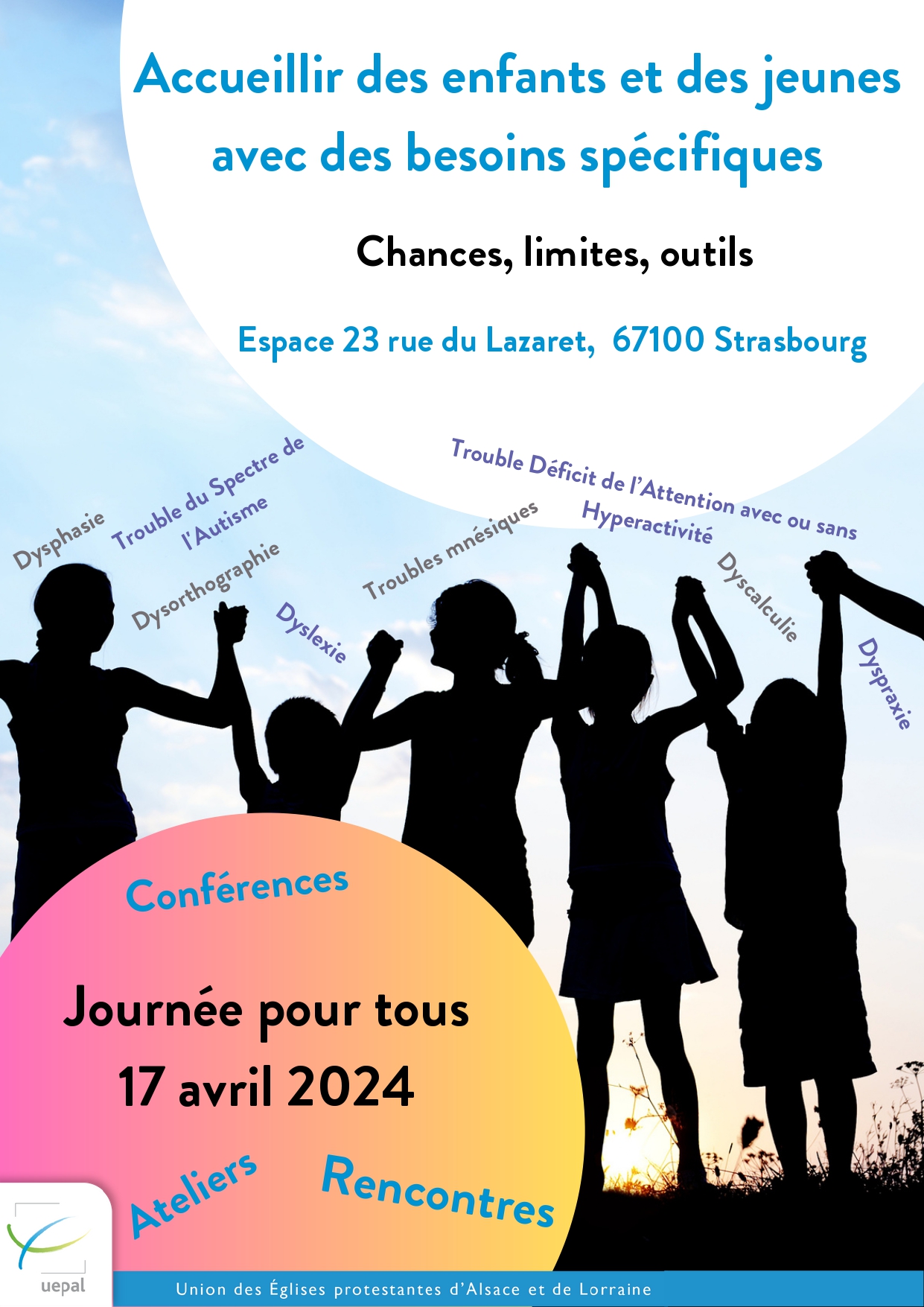Les chemins de croix de plein air, qu’on trouve en dehors des églises, sont des éléments d’un patrimoine populaire et religieux. Les spécialistes parlent d’un témoignage de “dévotion populaire”. Ils sont nombreux en Alsace et leur ascension permet de revivre la Passion du Christ, de s’élever spirituellement. Pour les non-croyants, ils sont aussi de belles destinations de promenade.
Les chemins de croix extérieurs aux églises, souvent implantés en pleine nature, à flanc de coteau, sont appelés des “monts calvaires”. Les croix, plus élaborées, y ressemblent à de petites chapelles ou oratoires. Ces édicules jalonnent un chemin qui grimpe vers les cieux. Ils figurent les quatorze stations (ou « Fussfälle ») de la Passion du Christ, celles de la montée au Golgotha. Mais ils n’ont pas pour seul objet d’exalter la souffrance du Christ. Ainsi, si la quatorzième station représente la mise au tombeau, il est commun d’ajouter un quinzième élément, qui évoque la résurrection, un signe d’espérance pour les chrétiens. Il représente communément un tombeau vide.
« Cela permet de montrer que le Christ, ce n’est pas une simple idée »
Ces chemins de croix escarpés sont nombreux en Alsace, implantés sur les contreforts des hauteurs vosgiennes ou sur des collines. La plupart ont été édifiés au XVIIIe siècle, souvent à l’initiative des Franciscains. Ils sont le témoignage d’une « dévotion populaire », selon l’expression de Benoît Jordan, conservateur aux archives de Strasbourg. En balisant le paysage, ils sortent la Passion du Christ de l’idée abstraite que le croyant pouvait s’en faire. Chaque édicule est orné d’une image, d’une citation, qui matérialise les étapes de la crucifixion qu’on commémore en ce Vendredi saint. « Cela permet de montrer que le Christ, ce n’est pas une simple idée. Le Christ était homme, et il a vécu cela. Et nous le prions », dit Olivier Becker, curé de la communauté de paroisses de Mutzig.
C’est ainsi que, ce vendredi 18 avril, les enfants de la paroisse se retrouvent à 10 h au tout proche chemin de croix de Still, l’un des plus anciens d’Alsace (érigé en 1789 à l’initiative du curé Jean-Étienne Straubhaar) et l’un des plus beaux. Chaque station est un édicule orné d’une image polychrome de style « néoclassique » selon l’historien local Pierre Blanchard. Still dispute le titre de « plus beau chemin de croix d’Alsace » à celui de Marlenheim, distant de 14 km seulement. Ce dernier gravit la colline du Marlenberg, au milieu des vignes, depuis 1772 – il a fêté dignement ses 250 ans en 2022. À cette occasion, le vigneron Vincent Muller avait proposé une « cuvée Ignacius » de 1772 bouteilles de riesling millésimé 2021, en hommage à Ignace Klein, le curé de Marlenheim auquel on doit la construction de ce monument.
Pour le financer, à l’époque, de riches donateurs (des vignerons, mais pas seulement) avaient délié leur bourse. Depuis, ce chemin de croix fait la fierté de la commune. « La première station se trouve au niveau du cimetière et ensuite on monte en dénivelé, décrit Geneviève Kapps, adjointe au maire chargée du tourisme. En haut, on a une vue jusqu’à la cathédrale de Strasbourg. On a parfois l’impression d’être au-dessus des nuages. Quand on en ressort, on a l’impression que quelque chose s’est passé. La petite chapelle au sommet est comme une vigie, une protection pour ce paysage de vignes. » Sept édicules de grès rose ponctuent la montée et sept autres stations de la Passion ont été apposées sur les murs de la chapelle.
Contemporain du Marlenberg, le site de Hoengoeft est souvent désigné comme « le plus populaire » en Alsace, ses sculptures remarquables rappellent celles du site de Pfettisheim – elles sont sans doute du même auteur, selon Emmanuel Fritsch, conservateur des antiquités et objets d’art du Bas-Rhin, mais sans que l’on connaisse son nom.
Léon Elchinger signe les images à Sainte-Odile et à Gildwiller
Léon Elchinger (1871-1942) a quant à lui signé plusieurs « monts calvaires » en Alsace. Le céramiste natif de Soufflenheim était le père de Léon-Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg. En 1934, il réalise les bas-reliefs du monument de Gildwiller, dans le Sundgau. Les édicules sont incrustés de scènes réalisées en faïence colorée. Ils partent du village et montent à travers la forêt. « C’est vraiment un très beau chemin de croix, s’enthousiasme l’abbé Jean-Paul Grandthurin. C’est vraiment à part, hors de toute circulation. C’est vraiment tranquille, c’est paisible et agréable… » Ce vendredi, à 17 h, les paroissiens de tous âges y seront au rendez-vous. Tout en haut, les jeunes qui font leur profession de foi se verront remettre des croix bénies. Tout près de la chapelle, où est représenté le tombeau vide, symbole de la résurrection. « En voyant les statues, les icônes, on sort de l’abstraction de la foi. On comprend ce qui s’est vraiment passé, cela permet de méditer », poursuit l’abbé Grandthurin.
Le même Léon Elchinger répond à la commande de Charles Ruch, évêque de Strasbourg, en 1932. Il est chargé de réaliser le chemin de croix extérieur du Mont Sainte-Odile, des bas-reliefs incrustés dans le socle de grès du sanctuaire. La bénédiction de l’ensemble a lieu durant la semaine sainte de 1935. La restauration menée en 2012 par l’atelier Pequignot et le sculpteur Patrick Lang, de Boersch, a permis de lui redonner tout son lustre.
D’autres constructions tout aussi emblématiques sont visibles en Alsace. À Ribeauvillé, on s’enorgueillit du chemin de croix de Notre-Dame du Dusenbach, lui aussi décrit comme « l’un des plus beaux » de la région. Long de 800 mètres, il a été aménagé en 1894, plusieurs fois restauré depuis. Initialement conçu dans les ateliers Meyer, à Munich, il offre quatorze oratoires le long d’un chemin escarpé, parfois dangereux – une septuagénaire y a fait une mauvaise chute en 2017. À Pfaffenheim et Gueberschwihr, le chemin de Notre-Dame-de-Schauenberg est bichonné par une association dévouée. Les futurs communiants y ont rendez-vous ce Vendredi saint. À Bischoffsheim, le chemin de croix du Bischenberg, datant de 1732, a été rénové en 2019 par Victor Karpenko, restaurateur d’œuvres d’art d’origine lettone.
On ne saurait être exhaustif s’agissant de la longue liste de tous ces éléments d’un patrimoine populaire. Dont l’objet, de nos jours, n’est pas seulement d’ordre religieux. Ces monts calvaires constituent aussi des détours de choix pour les randonneurs, ils offrent une prise de hauteur propice à tous les types de recueillement. Mais attention, met en garde un curé, la montée, parfois rude, risque de se transformer en véritable « chemin de croix », au sens figuré du terme, à qui n’aurait pas la condition physique requise.
https://c.dna.fr/culture-loisirs/2025/04/17/chemins-de-croix-un-patrimoine-tres-populaire